Plus que moins ou moins que plus ?
Patrick Simon fait ici la critique d’un article de François Héran publié dans Population & Sociétés en décembre 1993 sous la titre "L’unification linguistique de la France". Nous inviterons naturellement François Héran à lui répondre dans notre numéro de septembre.
Il arrive fréquemment que les chercheurs en sciences sociales soient amenés, dans les analyses quantitatives, à comparer leurs résultats et à les évaluer en ordre de grandeur. À chaque fois se pose la délicate question de l’étalon de référence qui sera choisi. Qu’est-ce qui décide qu’une pratique est fréquente ou qu’elle est rare ? Quand peut-on décider que c’est beaucoup, à partir de combien peut-on dire que c’est peu ?
Spontanément, vous allez répondre que ça dépend, ce qui, vous en conviendrez avec moi, ne nous avance pas beaucoup. Évidemment, l’appréciation des quantités, des seuils, des niveaux repose sur l’utilisation de grilles objectives : moyenne, écarts types, variance, l’outil statistique propose un nombre incalculable de tests pour évaluer la pertinence, la validité, la confiance que l’on peut accorder à un résultat et aux distances numériques qui séparent deux chiffres. Mais en dernier ressort, la véritable évaluation, celle du sens, se construit fondamentalement à partir d’une compréhension subjective des phénomènes. La plupart du temps, le chercheur investit dans son analyse tout un corpus d’hypothèses sur lequel il fonde la norme, sa norme. Au delà de ce niveau intuitif, c’est beaucoup, en deçà, c’est peu.
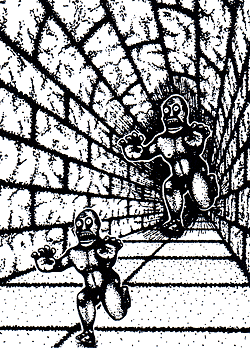
Epistèmê
À cette moyenne personnelle s’ajoute une connotation quasi affective. Si l’on accorde de l’intérêt à un phénomène, c’est qu’on cherche à démontrer quelque chose. La pseudo-rupture épistémologique fonctionne rarement et, à des degrés divers, on repère vite dans le travail des collègues ces petites manie qui trahissent l’engagement. Dans ces cas-là, on superpose à la hiérarchie des grandeurs une évaluation positive ou négative du résultat : beaucoup, c’est bien, plus c’est mieux ; au contraire, peu c’est inquiétant, encore moins c’est dramatique.
Chacun pourra puiser dans sa mémoire différents événements qui ont secoué le petit monde de la démographie pour débusquer des illustrations de cette dérive de la recherche. Pour notre part, nous voudrions proposer une lecture d’un texte paru dans "Population & sociétés", le bulletin mensuel de l’INED, où figurent plusieurs cas d’école de ces appréciations "Objectivement subjectives". Le texte en question traite de "L’unification linguistique de la France", c’est son titre, et a été publié en décembre 1993, dans le numéro 285, sous la plume de François Héran.
La langue enquêtée
L’auteur utilise les résultats de l’enquête "Efforts d’éducation des familles", réalisée par l’INSEE et l’INED sous sa direction, auprès de 5300 couples. Il exploite ici une question portant sur la "langue habituellement parlée par les parents" aux enquêtés et une autre concernant la langue que parlent habituellement" les enquêtés à leurs enfants. L’objectif de l’auteur consiste à démontrer que "l’unification linguistique de la France se poursuit". Il observe ainsi que 16% des personnes interrogées parlent autre chose que le Français (langue étrangère ou dialecte régional) et qu’ils ne sont plus que 5% à le parler à leurs enfants. Cette déperdition est traitée sur le mode emphatique : "une chute de cette ampleur, l’écrasante domination du Français, l’effondrement complet...".
En rapportant l’effectif de ceux qui parlent "habituellement" une langue étrangère ou un dialecte à leurs enfants à ceux qui le parlaient avec leurs parents, François Héran construit des taux d’abandon de la langue maternelle. En soi, ce calcul fournit d’intéressantes indications sur les "effets de milieu" et la dynamique du processus que l’on pourrait qualifier d’acculturation. Curieusement, l’auteur ne se situe pas sur ce terrain et privilégie une comparaison avec les dialectes régionaux, tels que l’alsacien ou le breton, dont on conçoit facilement que les locuteurs ne sont pas placés dans les mêmes conditions socio-historiques que les immigrés marocains ou portugais. À ce stade, la question du seuil à partir duquel le "taux d’abandon" de la langue s’établit à un niveau élevé ou faible apparaît centrale. Or, elle est constamment éludée. On apprend alors, et nous sommes obligé de l’accepter comme tel, que le portugais est "en voie de réduction rapide", de même que l’arabe, puisque les taux d’abandon se placent respectivement à 55% et 50%. L’auteur prédit même le passage au français dès la génération suivante.
Un esprit malicieux serait tenté de prétendre le contraire. N’observer en définitive que 50% de perte de l’arabe d’une génération à l’autre, alors que les enfants sont scolarisés à l’école française et doivent donc être bilingues, souligne une résistance peu commune.
Qui parle de quoi à qui ?
Quelles seront plus tard les pratiques linguistiques de ces enfants ? Nul ne le sait et ne peut s’engager à prédire un maintien ou l’abandon de la langue. Il reste probable malgré tout qu’avec la généralisation du français dans la jeune génération, la langue des parents, puis des grands-parents, ne subsiste qu’en tant que trace. Mais il nous est permis de douter de la qualité de la question de François Héran quand il cherche à mesurer la transmission d’une langue au travers de sa pratique exclusive. En effet, de nombreuses études ont montré qu’une distinction s’établit entre le parler familial et le langage scolaire, et ce quelles que soient l’origine et la langue des parents. Beaucoup d’enfants évitent d’utiliser les expressions familiales en classe car ils en connaissent la propriété affective. Ces mêmes enfants sont tout à fait capables de discriminer les mots de l’école et de ne pas les employer à la maison pour ne pas mettre en difficulté des parents moins habiles qu’eux dans le langage.
Ainsi, le langage familial est composite et, dans le cas des immigrés, on observe une alternance de français et de langue d’origine selon les contextes ou les thèmes de discussion. Les nuances qu’apportent les enquêtés quand on leur laisse le choix de la réponse viennent relativiser certains constats trop rapides. Une question sur la langue parlée avec ses enfants figure dans une enquête réalisée par l’INED sous la responsabilité de Michèle Tribalat et spécialement adressée aux immigrés. Elle comporte plusieurs modalités de réponse, de la langue maternelle exclusive au français exclusif en passant par des possibilités intermédiaires : "langue maternelle ou français, ça dépend de la situation", "langue maternelle ou français indifféremment", "le parent s’adresse en langue maternelle, l’enfant répond en français". Comme l’indiqueront les résultats, les niveaux de pratique de la langue d’origine et du Français qui se dégagent de l’enquête ne soutiennent pas les hypothèses avancées par François Héran.
D’une façon générale, les immigrés utilisent un langage qui manipule la langue d’origine et le français, illustrant ainsi la nécessaire fusion des apports respectifs.
Il faut donc rendre compte d’une pluralité des langages familiaux. Dans cette perspective, poser une question sur la langue "habituelle" revient à demander aux enquêtés de sélectionner une langue au détriment d’une autre, d’opérer une hiérarchisation préalable du langage qu’ils privilégient. En quelque sorte, croyant enregistrer une pratique, la question permet de délivrer un message qu’il est délicat de décoder : instrumentalisation du langage comme preuve d’intégration ou réel attachement au français ? Dans le contexte actuel, on mesure les déviations qui peuvent se produire.
"Si y a du vent..."
Précisément, François Héran ne se prémunit pas contre le reproche d’une exploitation légèrement idéologique. N’avance-t-il pas que la "situation de l’arabe en France est sans commune mesure avec celle dont jouit le français au Maghreb" ? Cette stupéfiante mise en parallèle de la langue du colonisateur avec celle des anciens colonisés devenus immigrés semble répondre aux craintes de ceux qui redoutent la dilution de l’identité française dans le grand bain du multiculturalisme. Allons, pas de panique, les Français parlent moins arabe que les Arabes ne pratiquent le français. Ouf ! Sans doute la comparaison avec les Portugais s’avère moins concluante, aussi ne figure-t-elle pas dans le texte. Si ces indications nous sont de peu d’utilité pour comprendre les mécanismes de transmission de la langue, elles nous renseignent sur les objectifs de l’auteur. Il s’agit de démontrer que la vitalité des langues "immigrées" n’est pas plus forte que celle des parlers régionaux, attestant ainsi la continuité d’un modèle d’assimilation nationale qu’on avait cru en perte de vitesse ces derniers temps.
Gageons cependant que les rythmes d’acculturation d’une population brusquement projetée dans un contexte socioculturel nouveau ne s’ajustent pas, sur le long terme, à ceux que suivent les groupes linguistiques régionaux, ne serait-ce que par la différence de traitement des identités régionales et immigrées et des rapports de force politiques qu’entretiennent ces groupes avec l’Etat français. Mais ces questions relèvent d’une autre étude. En ce qui concerne celle de François Héran, la réponse à la question posée, c’est à dire à quel rythme se perd la langue d’origine, nous a été fournie par Fernand Reynaud, illustre scientifique s’il en est. Pour se perdre, la langue ne va ni rapidement, ni lentement, elle met un certain temps.
Patrick Simon
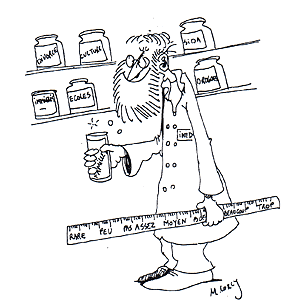
Pénombre, Juin 1994